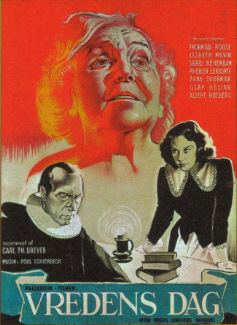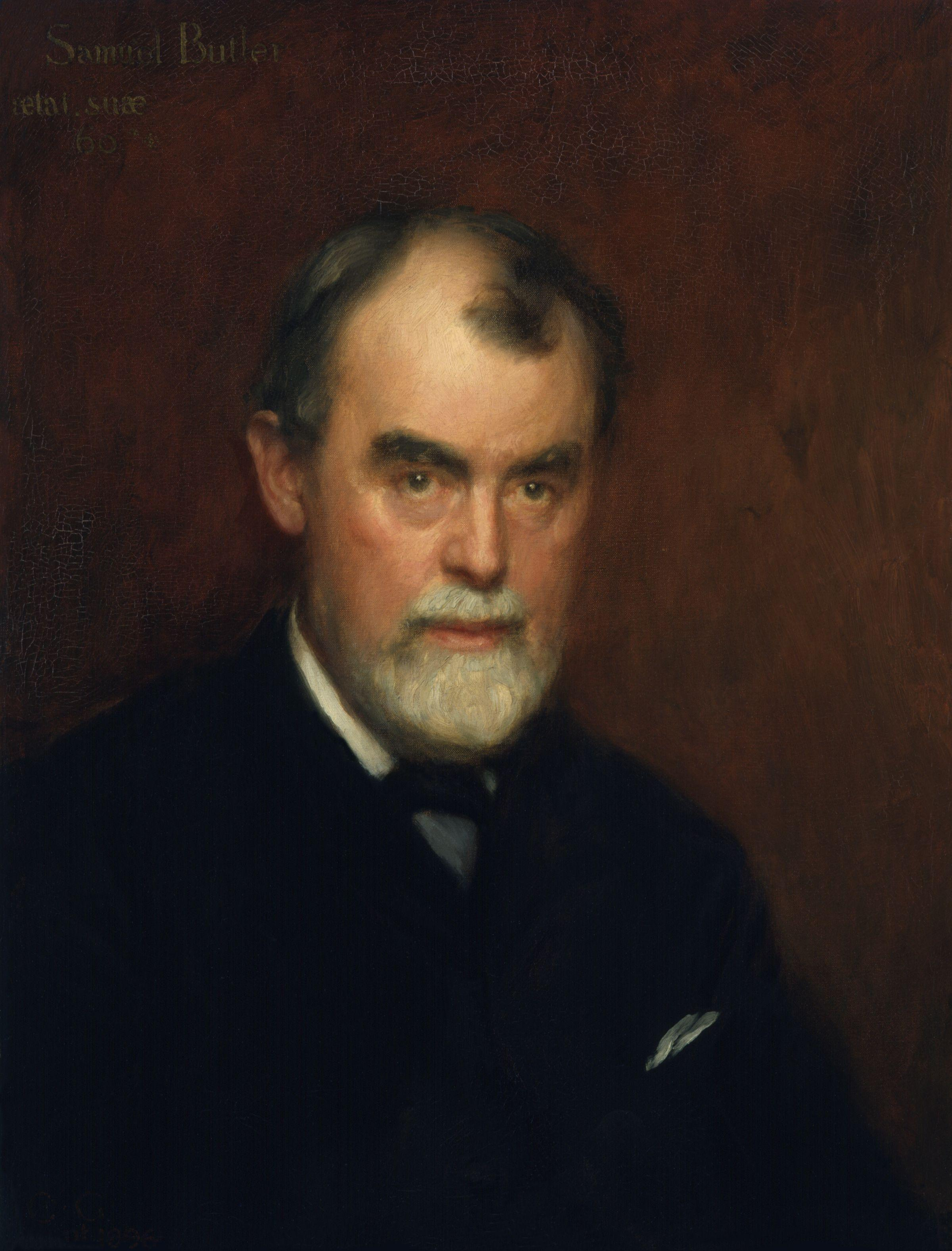"La Terre, le Feu, l'Esprit : chefs-d'oeuvre de la céramique coréenne" au Grand Palais du 27 avril au 20 juin 2016,


"Charles Le Brun, le peintre du Roi-Soleil" au Louvre-Lens du 18 mai au 29 août 2016,


"Masséot Abaquesne : l'éclat de la faïence à la Renaissance" au musée national de la Renaissance château d'Ecouen du 11 mai au 3 octobre 2016,


trois expositions fascinantes, trois expositions importantes, mais trois expositions non contemporaines et sous-médiatisées comme chaque lecteur habitué de ce blog peut aisément le comprendre...
La première exposition citée, "La Terre, le Feu, l'Esprit", organisée dans le cadre de l'année France-Corée s'est récemment clôturée dans un silence presque optimal, peut-être commandé par une polémique survenue dans le cadre des relations culturelles franco-coréennes, que Télérama a détaillée dans un article intitulé : Une exposition annulée, une directrice limogée, ce qui devait être un
des moment fort de l'année France-Corée 2016 a tourné au désastre. Cet article peut être lu dans la rubrique Arts & Scènes du site de Télérama. Cependant, j'estime que les silences presque intégraux autour de la manifestation du Grand Palais demeurent inexcusables en l'état. Il est vrai que nos "seigneurs" bobos, tout branchés et cosmopolites qu'ils soient, sont de tristes sires "anexotiques", anti exotiques, qui s'en fichent comme de leur première paire de chaussettes de l'ouverture, par exemple, d'une autre expo (cette fois au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac) consacrée au regard porté par l'art africain sur l'autre européen. Ce sont des incurieux notoires. Ils n'en ont rien à f... des céladons coréens, de toute une rétrospective consacrée aux arts du feu du Pays du Matin Calme, partant du temps distant des "Trois Royaumes" jusqu'à couvrir de nombreux siècles nous faisant cheminer des dynasties Goryeo et Joseon au monde contemporain.
Je pourrais en dire tout autant du Louvre-Lens, dont il est toujours plus incontestable au fil des mois (sur fond de baisse assurée du nombre de visiteurs, et pour cause !) qu'il souffre d'un manque croissant d'intérêt géographique et culturel (devrais-je écrire plutôt "cultureux" ou sociocul ?)
Le Louvre-Lens, par le biais de l'expo en cours sur Charles Le Brun (ce qui fait au mieux ronfler, somnoler, nos haineux de l'Histoire antérieure à la contemporanéité immédiate) est-il devenu la "poubelle" du Louvre-Paris ? Faut-il l'écrire ? Le Louvre-Paris est de moins en moins le musée du peuple voulu par la Révolution française. Il abandonne le public hexagonal et ouvertement, ne semble plus conçu que pour le seul public étranger bien pourvu en revenus (ou parvenu via les "décollages économiques") qui ne veut voir que les pièces majeures médiatiques (Joconde, Victoire de Samothrace, Vénus de Milo, Scribe accroupi etc.). Je pourrais épiloguer sur la flambée des prix d'entrée, sur les dérives commerciales, comme à Versailles etc. La mission d'instruction du peuple français aux Beaux-Arts est abandonnée ou presque, bien que l'actuel président-directeur, issu de la méritocratie républicaine, M. Jean-Luc Martinez, y soit favorable. Peut-être doit-il faire avec les dérives friedmano-hayékiennes de ses prédécesseurs. Résultat : 70 % des touristes au Louvre-Paris viennent de l'étranger, et nous assistons au déclin du nombre des visiteurs français. La proportion au Quai Branly représente l'exact contraire : 80 % de ses visiteurs sont originaires de l'Hexagone. Devrais-je ajouter à ce constat le jeu ambigu d'Arte qui, jusqu'à ce même jour où j'écris ces lignes, n'avait pas consacré le moindre documentaire au Louvre-Paris depuis X années ? Arte, dans ses sujets culturels (voués à 99 % à la création contemporaine) néglige d'ailleurs le Louvre et tout le reste du patrimoine conçu par Homo sapiens...


Je puis affirmer, non gratuitement, que le Louvre-Paris se repose toujours davantage sur le Louvre-Lens pour toutes les expositions jugées peu rentables, peu commerciales, trop pointues, donc peu médiatisées (par exemple le Moyen Age l'an passé ou une thématique festive générale brassant plusieurs siècles dans "Dansez, embrassez qui vous voulez" qui a précédé cet hiver Charles Le Brun). Le fiasco en nombre d'entrées de l'expo "Poussin et Dieu" fut-il déterminant dans les choix de répartition des responsables du "plus grand musée du monde" ? Il fut une exception toute récente : la rétrospective consacrée à Hubert-Robert, le peintre des ruines de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui, à la surprise générale, a fonctionné et trouvé son public. Là encore, je souligne que la presse papier a fait son travail, au contraire de l'a-télévision, rongée par le double cancer de l'audimat pour 99 chaînes sur 100 et de l'immédiateté contemporaine faisant sens pour la 100e au nom aisé à décrypter...
Les médias enfoncent souvent le clou, moins la presse écrite, qui fait encore peu ou prou son travail informatif, ainsi que je viens de l'exprimer plus haut au sujet d'Hubert-Robert, mais aussi Internet, bien que, par exemple Le Monde a parfois tendance à ne consacrer qu' in-extremis, dans le dernier mois de la manifestation, un article sur tel ou tel événement muséal non axé sur l'art moderne et contemporain. La télévision n'est pas en reste : elle se désintéresse de cela ou ne l'évoque qu'à des horaires matutinaux ou méridiens, lorsque personne n'est devant son poste, en brefs bouche-trous...
Il semble désormais exister un Louvre à deux vitesses, mieux, deux Louvre (s) :
- le Louvre des riches touristes étrangers à Paris (et accessoirement des bobos branchés) ;
- le Louvre du peuple à Lens, d'une région souffrant de la sinistrose de la désindustrialisation, Louvre-Lens qui a conservé les nobles et anciennes missions éducatives républicaines et de service public. Edifiant, me direz-vous. Je laisse de côté l'affaire du transfert des réserves "louvresques". Je ne suis pas spécialiste : lisez pour cela les dossiers et articles que la Tribune de l'Art a consacrés à cet épineux problème.
Mais le peuple a-t-il les moyens financiers et l'envie de se rendre à Lens ou Lens est-il de facto désormais presque exclusivement orienté vers l'accueil d'un public local ou régional (faut-il encore qu'il vienne...) ?
De toute manière, Arte ne parle jamais du Louvre-Lens (au commencement, du fait de son architecture contemporaine, puis plus rien depuis). Parallèlement, le site La Tribune de l'Art vient de souligner l'aberration d'une localisation de cette rétrospective Le Brun à Lens (la première en France depuis un demi-siècle) tout en soulignant les qualités remarquables de cette manifestation (bien illustrée de belles photos) qui permet de découvrir les premières étapes de la carrière de ce peintre sous Louis XIII et Mazarin (il naquit en 1619).
Reste à parler du musée national de la Renaissance d'Ecouen, un des plus négligés.
Nul ne peut contester le grand intérêt de l'exposition en cours consacrée à Masséot Abaquesne (1500-1564), ce grand céramiste et faïencier auquel Bernard Palissy,

son plus ou moins contemporain (1510-1589 ou 90, sa date de décès demeurant incertaine) a fait de l'ombre, quoique ces deux artistes majeurs soient tous deux fort bien représentés dans les collections nationales d'Ecouen. Cependant, par-delà le problème particulier de Masséot Abaquesne et de ses chefs-d'oeuvre admirables, force est de reconnaître que c'est l'ensemble du musée d'Ecouen qui ne suscite guère d'échos en général, par indifférence ou je-m'en-fichisme crasse. Masséot Abaquesne incarne un "illustre inconnu" de plus que nul n'est tenu de s'empresser de découvrir s'il n'en a point la volonté. Conséquemment, la rétrospective Abaquesne est, parmi tant d'autres misant sur les arts antérieurs à l'impressionnisme, souventes fois méconnus, davantage tournée vers un public d'amateurs éclairés, savants, sachants, convaincus d'avance, petit troupeau devenu infime et rare, composé de celles et ceux (tout comme moi) renseignés sur le fait fondamental que l'art humain débuta avec les gravures néandertaliennes récemment découvertes et non pas avec le Pop Art autour de 1960 ainsi que feint à l'exprimer le bobo bourdieusant détaché de l'ancienne culture "bourgeoise" moribonde, marginalisée, presque désormais underground, nouvelle contre-culture de niche écrasée par la précédente devenue culture officielle dominante.

Il est des musées nationaux incontournables, qui ont toute la pub, et d'autres, bien que remarquables et indispensables (toutes les époques historiques et préhistoriques sont bien représentées en France) qui demeurent toujours les perdants médiatiques dans l'affaire, et ce n'est pas notre seule chaîne culturelle ou soi-disant telle, quasi intégralement dépatrimonialisée, qui se souciera d'Ecouen, de Cluny ou même du Creusot (oui, l'écomusée du Creusot existe toujours !). Non, le monde n'est pas né à Woodstock 1969 mais en - 13 732 millions et quelques années.
Prochainement : reprise le mois prochain, en son treizième volet, de la série consacrée aux écrivains dont la France ne veut plus : Alphonse de Lamartine.

Nul ne peut contester le grand intérêt de l'exposition en cours consacrée à Masséot Abaquesne (1500-1564), ce grand céramiste et faïencier auquel Bernard Palissy,

son plus ou moins contemporain (1510-1589 ou 90, sa date de décès demeurant incertaine) a fait de l'ombre, quoique ces deux artistes majeurs soient tous deux fort bien représentés dans les collections nationales d'Ecouen. Cependant, par-delà le problème particulier de Masséot Abaquesne et de ses chefs-d'oeuvre admirables, force est de reconnaître que c'est l'ensemble du musée d'Ecouen qui ne suscite guère d'échos en général, par indifférence ou je-m'en-fichisme crasse. Masséot Abaquesne incarne un "illustre inconnu" de plus que nul n'est tenu de s'empresser de découvrir s'il n'en a point la volonté. Conséquemment, la rétrospective Abaquesne est, parmi tant d'autres misant sur les arts antérieurs à l'impressionnisme, souventes fois méconnus, davantage tournée vers un public d'amateurs éclairés, savants, sachants, convaincus d'avance, petit troupeau devenu infime et rare, composé de celles et ceux (tout comme moi) renseignés sur le fait fondamental que l'art humain débuta avec les gravures néandertaliennes récemment découvertes et non pas avec le Pop Art autour de 1960 ainsi que feint à l'exprimer le bobo bourdieusant détaché de l'ancienne culture "bourgeoise" moribonde, marginalisée, presque désormais underground, nouvelle contre-culture de niche écrasée par la précédente devenue culture officielle dominante.
Il est des musées nationaux incontournables, qui ont toute la pub, et d'autres, bien que remarquables et indispensables (toutes les époques historiques et préhistoriques sont bien représentées en France) qui demeurent toujours les perdants médiatiques dans l'affaire, et ce n'est pas notre seule chaîne culturelle ou soi-disant telle, quasi intégralement dépatrimonialisée, qui se souciera d'Ecouen, de Cluny ou même du Creusot (oui, l'écomusée du Creusot existe toujours !). Non, le monde n'est pas né à Woodstock 1969 mais en - 13 732 millions et quelques années.
Prochainement : reprise le mois prochain, en son treizième volet, de la série consacrée aux écrivains dont la France ne veut plus : Alphonse de Lamartine.