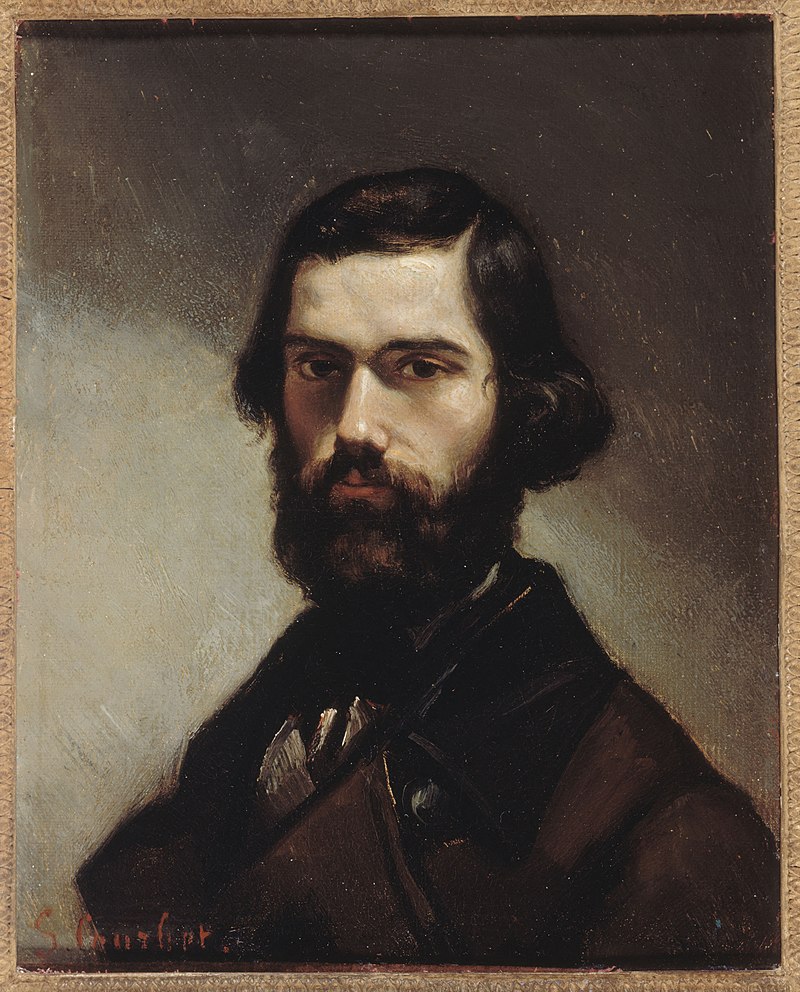Café
littéraire : L’Insurgé, de Jules Vallès.
Par
Christian Jannone.
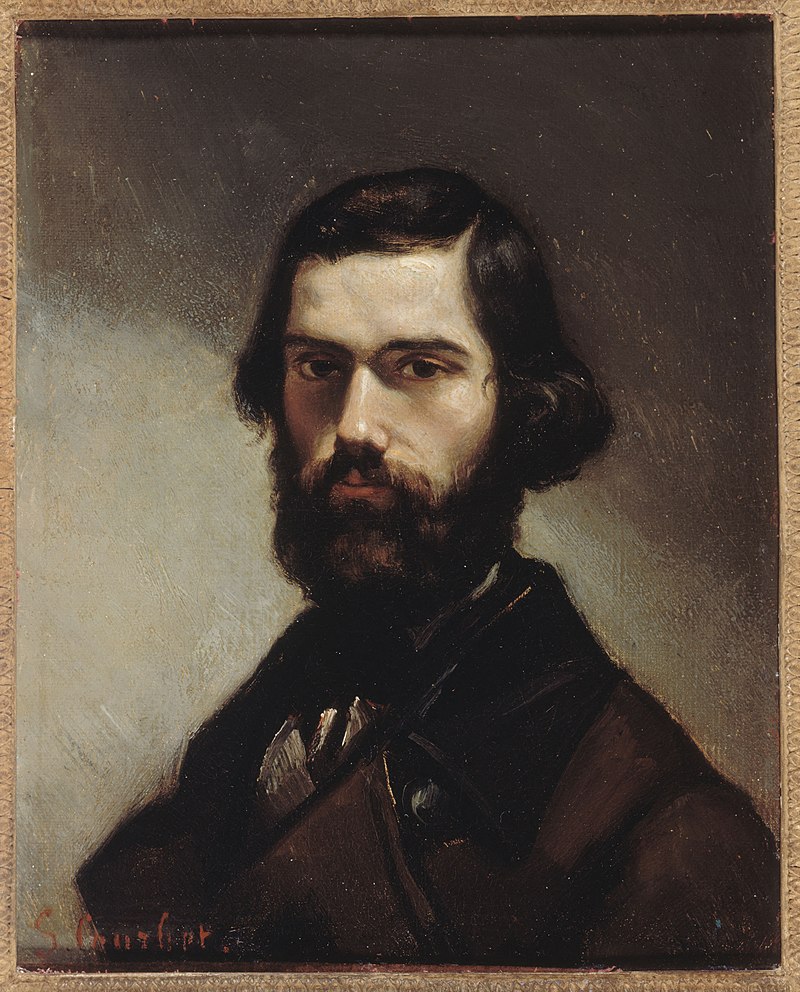
Jules Vallès (de son vrai
nom Jules Vallez), né au Puy-en-Velay (appelé à l’époque Le Puy) le 11 juin
1832 et mort à Paris (Ve arrondissement) le 14 février 1885, journaliste,
écrivain et homme politique engagé, survit dans nos mémoires grâce à sa
trilogie largement autobiographique L’Enfant, Le Bachelier et L’Insurgé.
Jacques Vingtras n’est cependant pas un calque total de Vallès, puisque des
divergences existent entre le vécu personnel de l’écrivain et celui de son
personnage central.
L’Insurgé, que
l’on ne peut qualifier d’autofiction avant l’heure, est un roman
pionnier : certes, il suit le premier livre historique consacré à la
Commune de Paris, Histoire de la Commune de 1871 de Prosper-Olivier
Lissagaray (1838-1901),

publié significativement à Bruxelles en 1876 mais il
précède La Débâcle d’Emile Zola, œuvre beaucoup plus romancée datant de
1892. De même, comme chez Zola, la Commune proprement dite – en y incluant la semaine
sanglante – n'occupe qu’une part assez restreinte de l’ouvrage : les
chapitres XXIV à XXXV.
La genèse de L’Insurgé
ne fut pas évidente. Exilé à Londres après la Commune, Vallès le mit en
chantier sous le titre de Jacques Vingtras III : c’était une mise
en évidence que le futur Insurgé prendrait le relais du Bachelier là
où il s’arrêtait. Il traitera donc des années 1860 (plus exactement à partir de
1862), des événements de 1870, des débuts de la République avec la guerre en
toile de fond et de la Commune.
Le rôle des femmes fut
décisif dans l’élaboration, le parachèvement et la publication intégrale du
livre, malheureusement posthume. Saluons d’abord le courage de Juliette Adam
(1836-1936),
 |
Juliette Adam par Nadar
|
qui, à peine obtenue – en 1880 – l’amnistie des communards,
s’attela à la parution d’une première version de L’Insurgé dans La Nouvelle
Revue en 1882 : version partielle, que Vallès retravailla, compléta
mais ne put paraître qu’après sa mort, grâce à Séverine – alias Caroline Rémy
(1855-1929) -

amie de Vallès depuis 1879. Elle le seconda dans la direction du
journal Le Cri du Peuple qui, en 1886 annoncera la publication de L’Insurgé
chez Charpentier. On a cru à tort que Séverine avait retravaillé l’écriture du
roman, ce qui est faux. C’est bien le texte voulu par Vallès que nous
connaissons.
Malgré le hiatus temporel
(passage direct de 1857 – date de la mort du père – à 1862), L’Insurgé s’enchaîne
là où s’achevait Le Bachelier, en réponse au « Sacré
lâche » de clôture :
« C’est peut-être
vrai que je suis un lâche, ainsi que l’ont dit sous l’Odéon les bonnets rouges et
les talons noirs. » Vingtras est devenu un pion.
Ce qui frappe d’emblée
dans le livre, c’est le style. On pourrait parler de modernité, du fait de la
prédominance du présent, du « je », du découpage en courts
paragraphes, de l’exclamatif, de l’utilisation d’une forme d’argot qui n’est
plus usité (par exemple le recours à l’argot des cochers p. 183 avec l’expression
« roues de derrière » désignant la pièce de 5 F en argent), d’une
narration qui peut paraître en même temps imagée, hachée, parfois triviale. Vallès
a recouru à une forme de collage, insérant dans son roman des textes du Cri
du Peuple, des passages écrits à chaud dans le déroulé des événements de la
Commune. On sent là la patte et du journaliste, et du militant politique.
Outre le style journalistique
– non péjoratif dans le sens où je l’emploie – Jules Vallès manie avec brio les
niveaux de langage, ce qui crée un contraste bienvenu entre la langue
recherchée de ceux que l’on n’appelait pas encore les intellectuels et la
langue populaire (cf. les différents types d’argot) : tout cela aboutit à
un roman très imagé, toutefois sans emphase, sans théâtralité, sans pathos, qui
en peu de mots, décrit tel ou tel personnage historique, ce qui n’est pas sans
rappeler la caricature dans le style de Daumier (que Vallès appréciait), qu’il
l’aime (Blanqui,

dont le portrait s’étale et se complète au fil du récit) ou
l’exècre (les membres du gouvernement provisoire de 1870, républicains déjà
opportunistes, tels Gambetta – qualifié de « plus capon » et de
« Danton de pacotille » p. 182 - ou Jules Favre).
Cela aboutit à une
galerie extraordinaire de portraits, souvent justes et acides, dignes des
meilleurs satires. Le tandem contrasté Villemessant du Figaro et
Girardin (La Presse puis La Liberté) mérite qu’on s’y arrête.
Emile de Girardin
d’abord :

« Quel visage
blafard ! Quel masque de pierrot sinistre !
Une face exsangue de
coquette surannée ou d’enfant vieillot, émaillée de pâleur, et piquée d’yeux
qui ont le reflet cru des verres de vitres ! On dirait une tête de mort,
dont un rapin farceur aurait bouché les orbites avec deux jetons blancs, et
qu’il aurait ensuite posée au-dessus de cette robe de chambre, à mine de
soutane, affaissée devant un bureau couvert de papiers déchiquetés et de
ciseaux les dents ouvertes. Nul ne croirait qu’il y a un personnage
là-dedans ! » (p. 54-55)
Hippolyte de Villemessant
p. 75 :

« C’est un Girardin
avec de gros yeux ronds, les bajoues blêmes, la moustache d’une vieille
brisque, la bedaine et les manières d’un marchand d’hommes, mais amoureux de
son métier et arrosant d’or ses cochons vendus. »
P. 76 : « Il
est du momifié de la Liberté comme du poussah du Figaro. »
P. 77 : « Shakespeariens à
leur façon, ces deux journalistes du siècle : l’un traînant le ventre de
Falstaff, l’autre offrant la tête d’Yorick aux méditations des Hamlet ! »
(…)
A côté d’eux, combien de
noms que nous ne connaissons plus du tout ! Tant de noms de communards, de
personnages révoltés comme lui dont Vallès croisa la route qui nécessitent des
notes de bas de page pour en cerner une esquisse d’identité et de personnalité.
Car l’Insurgé est avant tout un hymne à la liberté et à la révolte, un
hommage aux personnes qui donnèrent leur vie à la Commune contre une société
d’injustice, héritiers de 48, des sacrifiés des journées de juin

auxquelles
Vallès fait plusieurs fois allusion, puisque sa conscience politique s’éveilla
lors de ces événements tragiques survenus durant son adolescence. Ainsi
comprenons-nous la dédicace du livre, hommage à tous les morts de 1871.

L’histoire individuelle
de Vingtras rejoint durablement celle du pays à compter du chapitre XV, à
partir duquel les événements de sa vie se confondent jusqu’au bout du roman
avec les épisodes majeurs des années 1870-1871, en commençant par le meurtre de
Victor Noir par Pierre Bonaparte.

A compter du 10 janvier 1870 et jusqu’au dernier
jour de la semaine sanglante, notre insurgé est emporté par les tumultes de
l’accélération de l’histoire. Certes, il a connu censure et prison
(Sainte-Pélagie, dévolue aux journalistes) ; certes, il a été candidat aux
élections législatives de 1869 qui virent le ralliement d’Emile Ollivier à
l’Empire prétendument libéral, mais jamais notre personnage, depuis 1848, ne
s’était retrouvé autant au cœur de la mêlée et de la tragédie. Il est utile de
rappeler que le Second Empire, dont les réformes des années 1860 avaient été
approuvées par plébiscite, ne se serait pas effondré sans la déclaration de
guerre fautive à la Prusse de Bismarck. Le clivage s’accentua avec la lutte
entre les républicains opportunistes siégeant au gouvernement provisoire et les
partisans de la république sociale. N’oublions pas les événements annonciateurs
de la Commune narrés par Vallès aux chapitres XX et XXI qui couvrent la
tentative insurrectionnelle des 5 et 6 septembre 1870 puis l’échec de la
manifestation du 31 octobre 1870 contre le gouvernement de la Défense
nationale, avec la répression qui s’ensuivit. Notons à cette occasion l’usage
par Jules Vallès de la thématique des uniformes, des grades et des galons (p.
201 ouvrant le chapitre XX). L’uniforme devient un oripeau de théâtre à valeur
symbolique.

Vallès multiplie donc les
portraits au fil des événements dont la narration s’accélère, portraits
d’acteurs de la Commune, via un kaléidoscope d’images éclatées, fragmentées,
métaphoriques, résumant ces hommes de la grande histoire à un nom, une formule,
un geste, une parole. On pourrait reprocher à Vallès d’avoir négligé le rôle
des femmes, qu’importe ! Cette fragmentation narrative extraordinaire va
de pair avec la nervosité du style, la brièveté des paragraphes, haletants,
hachés, qui atteignent leur paroxysme avec la semaine sanglante : nous
avons-là un témoignage sur le vif, comme en direct, d’un diariste plongé au
cœur de l’accélération du temps courant vers le tragique. Tout à la fois témoin
clé, acteur central, porte-étendard des victimes de la répression versaillaise,
militant de la mémoire communarde, conteur d’une histoire personnelle, du je
inclus dans le collectif, Jules Vallès, à mon sens, réussit mieux à nous
émouvoir et à nous captiver que Lissagaray – que je n’ai pas lu - et Zola (le
texte naturaliste de La Débâcle de
Zola – outre qu’il entérine la thèse des saboteurs versaillais infiltrés ou
« retournés » responsables du brasier de la capitale destiné à
discréditer les communards en plus des exécutions de leurs adversaires pris en
otages tel l’archevêque de Paris - est davantage « travaillé », en
conformité avec la littérature de la fin du XIXe siècle, trop romancé ai-je
écrit, pour emporter pleinement l’adhésion). La Commune vue par Vallès donne
sans cesse l’impression d’un « direct », caméra à l’épaule, prélude
au film de Peter Watkins, tourné en noir et blanc, trop peu souvent montré,
long documentaire typique de ce cinéaste, brut de décoffrage, qui joue avec la
collision entre le contemporain et l’historique (le film de Watkins aurait
mérité une rediffusion en épisodes à l’occasion des 150 ans de la Commune). Les
journalistes modernes, de l’an 2000, décrédibilisent la vision versaillaise des
événements. Ce télescopage se retrouvait déjà, de manière plus classique, dans
l’émission de Claude Santelli consacrée à L’Insurgé,
tournée en 1970, incluse dans la série Les
Cent Livres des Hommes, évocation de Vingtras-Vallès jouée par un Victor
Lanoux immergé dans le Paris pompidolien (vidéo disponible par abonnement au
site madelen).

Je ne reviendrai pas sur
les circonstances permettant à Vallès, grâce au faux-semblant, au
travestissement de l’ambulancier de la Croix Rouge, d’échapper à la répression,
de devenir un proscrit, un exilé, tandis qu’on fusillait à sa place des
victimes prises pour lui. Il est dommage d’apprendre le quasi silence qui
entoura le roman lors de sa publication posthume de 1886 – y compris de la part
du Cri du Peuple ! Un livre qui
longtemps dérangea, fut moins mis en avant que L’Enfant ou même Le
Bachelier, bénéficia de rares réimpression, jusqu’à enfin recevoir la
pleine légitimité littéraire et historique grâce aux éditions de poche. Comme
s’il avait fallu attendre le centenaire de 1971 et la fin du XXe siècle pour
que L’Insurgé trouve enfin sa place
dans le panthéon littéraire : celui des classiques et des chefs-d’œuvre.

Prochainement : commémorations 2022 : Léon Blum oublié.